Découvrez le métier, « intense et boostant », d’Amélie, qui après un doctorat en chimie organique a choisi de devenir ingénieure de production chez BASF.
Lien direct sur YouTube
 |
Nouveaux ouvrages Chimie et… disponibles en ligne
|
Nouveaux ouvrages Chimie et… disponibles en ligne
Rubrique(s) : Événements
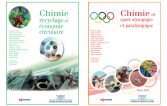
Deux nouveaux ouvrages de la collection Chimie et… sont disponibles en ligne.
Chimie et sport olympique et paralympique : téléchargez le PDF
Chimie, recyclage et économie circulaire : téléchargez le PDF
Retrouvez les derniers colloques Chimie et… dans l’Espace Colloques (livre intégral, vidéos, chapitres de conférences…).
Retrouvez ici le colloque Chimie et Alimentation (février 2025)
Retrouvez les colloques les plus récents
Chimie et Eau : Présentation du colloque
Depuis l’aube de l’humanité l’eau et la vie sont indissociables.
Aujourd’hui, les besoins en eau évoluent avec les modes de vie et, de façon différente, sur notre planète. Avec le changement climatique, le cycle de l’eau a lui aussi évolué. L’accès à l’eau, et encore plus à l’eau potable, est devenu un enjeu sanitaire et industriel et souvent même une source de tensions géopolitiques.
Il faut préserver la ressource en eau. La gestion de l’eau, sa qualité et les risques de pénurie sont devenus des enjeux majeurs pour les populations et les gouvernements Les industriels, notamment les industriels de la chimie, sont maintenant fortement mobilisés.
Les défis à résoudre sont nombreux, les problèmes sont multidisciplinaires, mais la place de la chimie est importante dans beaucoup des solutions actuellement mises en œuvre comme dans celles en cours de recherche et de développement. Nous avons dû limiter notre choix aux sujets qui nous semblaient actuellement les plus importants ou les plus innovants. Ils concernent l’identification et le traitement des micropolluants et des risques sanitaires, la gestion plus sobre des eaux industrielles, le recyclage et le traitement des eaux et boues usées, la préservation de l’humidité des sols, la capture de l’humidité atmosphérique…
Les conférenciers ont été choisis parmi les experts universitaires et industriels de ces domaines pour répondre avec rigueur scientifique et objectivité a ces questions qui préoccupent actuellement tous les citoyens et notamment les jeunes et leurs formateurs. Car la mise en œuvre des solutions nécessite une main d’œuvre multidisciplinaire bien formée et les choix d’orientation vers ces secteurs porteurs se font dès nos lycées de formation générale ou professionnelle.
Un temps sera consacré à de larges débats.
Danièle Olivier
Vice-Présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie
Chimie et Eau : Le colloque dans son intégralité

- Regardez toutes les vidéos sur Youtube/Mediachimie
- Retrouvez le colloque sur le site de la Fondation de la Maison de la Chimie
- Programme du colloque (PDF)
- retrouvez le quiz Chimie et eau (avant colloque)
- retrouvez le quiz Chimie et eau (2) (post-colloque)
- parcourez une sélection de ressources disponibles sur Mediachimie : Eau et Chimie
- lisez la fiche Les Chimistes dans : Les chimistes dans : les métiers de l'eau
- regardez la vidéo Petite histoire de la chimie : L'eau, quelle histoire ?
Chimie et Eau : Conférence par conférence
Conférences plénières d’ouverture
Animateur : Philippe GŒBEL | Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie
- - L’eau, enjeu vital, ressources et tensions
- Marie-Hélène AUBERT | Inspectrice générale honoraire de l’administration de l’environnement et du développement durable, ancienne parlementaire
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Le cycle continental de l’eau et la ressource mondiale associée : évolution récente et projections futures
- Bertrand DECHARME | Directeur de recherche CNRS au Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM, Université de Toulouse, Météo-France, CNRS UMR 3589)
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF
Table Ronde : Préserver la ressource – Eaux potables et industrielles
Animateurs : Philippe PRUDHON | Fondation de la Maison de la Chimie
Jean-Claude BERNIER | Professeur Émérite de l’Université de Strasbourg
- - Préserver la ressource eau – Exemple de la Chimie
- Patrick CLERET | Directeur des affaires techniques, France Chimie
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Actions concrètes de réduction des prélèvements d’eaux industrielles
- Patrick RENCK | Responsable Environnement, Alsachimie
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Des stations d’épuration toujours plus performantes pour réutiliser les eaux
- Christelle PAGOTTO | Chef de Projet Qualité Assainissement, Veolia Eau France
Stanislas POURADIER DUTEIL | Directeur Technique - Direction des Opérations, Veolia Eau France
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Cas concret de réutilisation d’eaux industrielles dans l’industrie laitière
- Fabrice LETENEUR | Président du SYPRODEAU et Président de néEAU
Jérôme MONTAGNIER | Directeur Général de DR. KUEKE France
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Osmose Inverse, de la fabrication des membranes à l’exploitation des méga-usines – Réalisations et perspectives
- Jean-Baptiste THUBERT | Directeur Technique et Innovation, Veolia Water Technologies
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF
Eau et Innovation
Animatrice : Marina COQUERY | Directrice de Recherche, Unité de recherche RiverLy, INRAE
- - Les micropolluants : méthodologies innovantes pour mieux les explorer dans les rejets et les milieux aquatiques
- Cécile MIEGE | Directrice de recherche en chimie environnementale, INRAE, UR RiverLy
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Traitement des contaminants dans les usines de potabilisation
- Laurent MOULIN | Responsable du département R&D, Eau de Paris
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Les techniques analytiques pour évaluer la santé des populations par les eaux usées
- Thomas THIEBAULT | Maître de conférences à l’EPHE-PSL et membre de l’UMR METIS
Stanislas POURADIER DUTEIL | Directeur Technique - Direction des Opérations, Veolia Eau France
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - L’ensemencement des nuages, progrès et limites
- Andrea FLOSSMANN | Professeur à l’Université Clermont Auvergne
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF - - Chimie et eaux souterraines
- Alain DUPUY | Directeur de Programme Gestion des Eaux Souterraines - BRGM, Co-directeur du Programme de recherche OneWater - Eau Bien Commun - CNRS, BRGM, INRAE
voir la vidéo et le résumé | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF
Conférence Plénière de Clôture
Animatrice : Danièle OLIVIER | Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie
- - L’eau, un bien commun : enjeux et perspectives
- Agathe EUZEN | Directrice de Recherche CNRS au LATTS, Directrice adjointe de CNRS Écologie & Environnement, Co-directrice du Programme national OneWater - Eau Bien commun (CNRS, BRGM, INRAE)
voir la vidéo | Prochainement en ligne : le chapitre en PDF
Les eaux souterraines forment du point de vue volumique le deuxième plus grand réservoir d’eau non salée de notre planète avec 30% du volume total1, seulement devancé par les glaciers et calottes (~70 %) et largement devant les eaux de surface (~0,5%). À ce titre et du fait d’une accessibilité plus importante sur l'ensemble du territoire que les deux autres réservoirs, les eaux souterraines constituent une ressource essentielle pour la quasi-totalité des activités humaines fondées sur des eaux douces (près des 2/3 tiers de l'eau potable par exemple). C'est pourquoi il est important de suivre leur évolution quantitative comme qualitative, mission qui échoit pour une grande part au BRGM. Bien que globalement qualifiées d’eaux douces, la qualité des eaux souterraines peut varier significativement du fait de constituants naturels présents, ou par les nombreuses substances d'origine humaine introduites par les activités humaines. Quantité et qualité des ressources en eaux sont ainsi les deux faces de la science des eaux souterraines qu’est l’hydrogéologie, et explique la mobilisation de longue date du BRGM pour développer des méthodes d'analyse chimique performante et adaptée à cet environnement.
La chimie permet au travers de la géochimie et de l’hydrochimie de qualifier l’état d’une ressource en eau, d’une nappe ou d’un aquifère. Le suivi et l’évolution des molécules issues de nos activités et introduites dans les nappes et aquifères (i.e. nitrates, phytosanitaires, perturbateurs endocriniens, PFAS…) permet grâce aux développements analytiques et aux outils associés une caractérisation de plus en plus fine de la composition chimique d’une ressource. La chimie permet également d’appréhender l’évolution naturelle de la qualité d’une ressource en fonction de la nature des roches qui contiennent l’eau. La présence et la concentration de certains éléments peuvent ainsi déterminer l’usage final d’une ressource. La présence de sélénium, de fluor ou d’arsenic peut être strictement naturel dans certaines eaux souterraines, mais les valeurs de concentration peuvent en interdire l’usage pour la production d’eau pour l’alimentation humaine, ou aussi en autoriser l’usage à des fins médicales (eaux thermo-minérales).
La chimie a également permis d’appréhender une partie spécifique aux ressources en eau souterraine à savoir l’âge de l’eau. Ce volet de l’hydrogéologie2 a particulièrement été développé via la chimie isotopique de la molécule d’eau, mais aussi d’éléments pouvant être présents dans les eaux comme les sulfates, le strontium, l’uranium, le thorium, le bore… Les traceurs isotopiques généralement utilisés en hydrogéologie associent des traceurs d’interaction eau-roche, de mélange et d’origine des eaux, de processus…, chaque traceur couvrant une ou plusieurs de ces caractéristiques. L’association de ces outils permet d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement des systèmes aquifères et compléter ainsi la vision sur les circulations des eaux souterraines en complément des approches hydrodynamiques.
La chimie joue donc un rôle central dans la compréhension du fonctionnement des aquifères et des ressources en eaux qu’ils contiennent. L’hydrogéologie s'est essentiellement appuyée sur la chimie minérale au début, puis la nature des polluants anthropiques évoluant, la chimie organique a été associée à la caractérisation de la qualité des ressources. Elle forme le fondement du suivi des molécules et des métabolites actuellement rencontrées dans certaines ressources. Plus récemment
encore la biochimie et ses développements dans les milieux naturels du sous-sol ont été utilisés pour la compréhension des circulations des eaux souterraines, la qualification qualitative des ressources en eau par la dégradation de certains métabolites ou encore la présence ou le suivi de certains microorganismes dans le sous-sol.
Références :
- OIEau, La part d’eau douce sur Terre, 2017
- L. Ortega et L. Gil, L’Eau : Hydrologie isotopique. Bulletin de l’AIEA, avril 2019, 2019
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
Le souhait d’influencer la météo en notre faveur semble être codé dans nos gènes. Depuis le début de l’humanité on prie pour la pluie et un temps favorable.
Les progrès de la science nous ont aidé à comprendre le fonctionnement des nuages et le rôle des particules d’aérosol dans leur formation et développement. Récemment, le souhait de changer la météo est devenu urgent du au changement climatique en cours. Le problème d’une disponibilité fiable de l’eau potable mène de plus en plus de pays à se lancer dans des campagnes de modification du temps en ajoutant des particules d’aérosol qui se substituent ou complètent les particules naturelles. Deux approches sont à distinguer :
- dans la première, des particules solubles et grosses sont ajoutées et vont former des gouttes suffisamment grandes pour déclencher la pluie.
- dans la deuxième, on ajoute des particules qui servent à convertir des gouttes en cristaux de glace (ex : AgI) dans des zones du nuage proche du niveau 0°C dans le but de convertir l’eau en glace précipitante.
L’extrême variabilité naturelle des nuages rend la preuve de l’efficacité de l’ensemencement très difficile. 50 ans après la découverte de l’impact potentielle des particules sur l’évolution du nuage, la preuve scientifique restait introuvable. Seulement depuis les derniers 20 ans, des progrès ont finalement était faits.
Dans un souhait de réduire la variabilité naturelle du nuage, une première étude convaincante a été menée dans les nuages hivernaux qui se formaient lors d’une ascension forcée d’air sur un relief montagneux. En utilisant AgI, la campagne a produit de la neige dans un bassin versant de réservoir d’eau.
Dans des nuages convectifs des campagnes prometteuses sont en cours qui utilisent la procédure de double aveugle de la médecine et nécessitent un nombre important de cas à traiter.
La présentation va traiter les différentes approches possibles, les progrès, les limites, les verrous et risques des différentes méthodes. On discutera si la modification du temps a le potentiel d’un outil fiable dans un futur imminent.
Références :
- Flossmann, A.I., M. J. Manton, A. Abshaev, R. Bruintjes, M. Murakami, Th. Prabhakaran, Z. Yao: Review of Advances in Precipitation Enhancement Research; Bull. Atm. Met. Soc., 1465-1480, DOI: 10.1175/BAMS-D-18-0160.1, 2019.
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
Depuis les années 1970, l’impact des rejets d’eaux usées sur la qualité physico-chimique et écologique des milieux aquatiques a été documenté et deux grands mouvements en parallèle ont permis de le limiter, d’un côté l’amélioration de la collecte des eaux usées brutes, et de l’autre l’amélioration des traitements épuratoires dans les stations de traitement des eaux usées. Si des améliorations peuvent encore être apportées, les chercheurs et les opérateurs tournent leur regard de plus en plus vers les eaux usées brutes, considérées comme des mines d’or. Riches en nutriments et en énergie, les eaux usées ont le potentiel d’être considérées non plus seulement comme un déchet, mais comme une ressource. De plus, les eaux usées brutes contiennent un signal moléculaire très diversifié et concentré, car non atténué par les stations d’épuration. Aussi, l’utilisation de cette information moléculaire (contaminant organique, bactéries, virus) pour évaluer l’état de santé des populations s’est fait jour au tournant des années 2000 notamment sur les usages de drogues. Estimer des usages en produits illicites est, par nature, une gageure. Si des entretiens ou des estimations à partir des volumes saisis par les autorités sont classiquement utilisés, la quantification de l’usage de substances illicites reste relativement imprécise, les eaux usées ont donc été proposées en 2001 pour réaliser cette estimation collective dans le but d’un suivi dit objectif, effectué depuis lors à l’échelle européenne. « Dites-moi ce que vous excrétez, je vous dirai ce que vous consommez ».
La pandémie de Covid19 a par la suite provoqué un engouement international autour de cette approche alors que l’analyse rétrospective des eaux usées, notamment à Barcelone et à Milan a démontré la présence de matériel génétique de Sars-Cov2 dès la fin 2019, avant les premiers diagnostics en 2020. Cette capacité de l’eau usée à permettre une veille épidémique (dans la mesure où l’on sait ce que l’on doit chercher !) a été exploitée entre 2020 et juillet 2022 dans les principales aires urbaines françaises, environ une quarantaine, dans le cadre du programme OBEPINE.
Aujourd’hui, le principal enjeu pour la communauté scientifique est de lier quantitativement un usage à la présence et la quantité d’une substance dans les eaux usées, ainsi que de poursuivre la diversification des traceurs à utiliser, comme les produits pharmaceutiques, le bol alimentaire ou encore le stress oxydatif. Toutefois, l’eau usée est une matrice complexe à analyser et l’identification de traceur spécifique et quantitatif n’est pas toujours aisée. Aussi, si le potentiel des eaux usées pour évaluer l’état de santé se fait jour, il demeure encore des obstacles à lever, analytiques et conceptuels, pour maximiser cette approche.
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
Malgré les efforts déployés pour protéger la qualité de ces ressources en eau potable, un certain nombre de contaminants chimiques et microbiologiques d'origine anthropique se retrouvent dans l'eau et nécessitent des traitements spécifiques pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les pollutions touchent aussi bien les eaux souterraines et les eaux de surface, même si elles sont souvent différentes. À Eau de Paris par exemple (l’établissement publique responsable de la production et de la distribution de l'eau potable pour l'ensemble de Paris intramuros) la ressource en eau est issue à parts égales des eaux de surface et des eaux souterraines, traitées de façon différentes.
Les avancées technologiques récentes dans le domaine de l'analyse de l'eau, telles que les spectromètres de masse toujours plus performants ou l'introduction de techniques de biologie moléculaire, ont profondément modifié la manière dont les contaminations sont identifiées et quantifiées. Cela a conduit à un renforcement des processus de traitement afin de répondre à ces nouvelles préoccupations. À travers plusieurs exemples, que ce soit en chimie (suivi des métabolites, par exemple) ou en microbiologie (notamment la surveillance des pollutions virales), nous examinerons comment les usines de traitement de l'eau se sont adaptées pour éliminer ces composés récemment identifiés et comment ces nouvelles méthodes analytiques ont été intégrées dans les pratiques de suivi de la qualité de l’eau.
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
Les micropolluants organiques sont des molécules issues de l’industrie chimique que l’on retrouve fortuitement dans l’Environnement dans lequel ils ont une action toxique à des concentrations infimes (< μg.L-1 dans les eaux, < μg.kg-1 dans les particules en suspension ou sédimentées). On peut citer comme exemples : les pesticides à usage phytosanitaire ; les molécules à usage tensioactif (e.g. alkyphénols, alkylbenzènes sulfonates, …) ; les molécules à usage retardateur de flammes (e.g. polychlorobiphényles-PCB, polybromodiphényléthers-PBDE, …) ou imperméabilisant et antiadhésif (e.g. perfluorés-PFAS, …) ; les molécules pharmaceutiques et hormones à usage thérapeutique ; les filtres UV et agents humectant à usage cosmétique ; les colorants à usage agroalimentaire ; les molécules à usage de conservateur (e.g. parabènes dans les cosmétiques, …), etc. Ce type de pollution chimique représente la 5ème limite planétaire (sur 9) franchie selon les scientifiques du SRC (Stockholm Resilience Center, Persson et al., 20221), et est considéré comme l’un des principaux facteurs responsables du déclin de la biodiversité selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, rapport 20192).
Un premier défi pour étudier ces micropolluants concerne leur échantillonnage dans les rejets et les milieux aquatiques. Il doit être représentatif dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire qu’il doit permettre de comprendre ou d’intégrer la variabilité temporelle ou spatiale. Sur ce sujet, l’échantillonnage intégratif par piège à particule3 pour les matières en suspension ou par échantillonneur passif4 pour la phase dissoute sont pertinents et se développent.
Un second défi concerne l’analyse de ces molécules, qui est réalisée avec des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse (basse ou haute résolution, LRMS ou HRMS). Différentes stratégies d’analyses sont envisageables pour différents niveaux d’informations : i) les analyses ciblées permettent de couvrir jusqu’à une cinquantaine de molécules par méthode, et d’avoir une information très précise sur leur identité et leur concentration ; ii) les analyses suspectées5 permettent de couvrir plusieurs centaines de molécules, et d’avoir une information plus globale, sur leur présence ou absence, avec un indice de confiance plus ou moins fort sur leur identité ; iii) les analyses non ciblées5 permettent de couvrir plusieurs milliers de signaux issus de l’HRMS, correspondant à des molécules non identifiées et non nommées, et d’avoir une information encore plus globale et exhaustive.
Références :
- L. Persson, B.M. Carney Almroth, C.D. Collins, S. Cornell, C.A. de Wit, M.L. Diamond, P. Fantke, M. Hassellöv, M. MacLeod, M.W. Ryberg, P. Søgaard Jørgensen, P. Villarrubia-Gómez, Z. Wang, M.Z. Hauschild. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environ Sci Technol. 2022; 56(3):1510-1521. doi: 10.1021/acs.est.1c04158. Epub 2022 Jan 18. PMID: 35038861; PMCID: PMC8811958.
- S. Díaz, J. Settele, E.S. Brondízio, H.T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K.A. Brauman, S.H.M. Butchart, K.M.A. Chan, L.A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S.M. Subramanian, G.F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y.J. Shin, I.J. Visseren-Hamakers, K.J. Willis, and C.N. Zayas (eds.). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES (2019): IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.
- zabr.assograie.org/wp-content/uploads/2022/03/Fiche_outil_ZABR_PAP.pdf
- aquaref.fr/chimie/eip-echantillonnage-integratif-passif
- S. Merel, C. Margoum, K. Rocco, M. Coquery, C. Miège. Intérêt pour la directive cadre européenne sur l’eau de l'analyse chimique non-ciblée de micropolluants organiques dans les milieux aquatiques. Sciences Eaux & Territoires 37 (2021), 110-113, dx.doi.org/10.14758/SETREVUE.2021.4.20, hal.inrae.fr/hal-03602658
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
L'osmose inverse, procédé de séparation membranaire, est largement utilisée pour purifier l'eau en éliminant les contaminants dissous. Ses applications principales incluent le dessalement de l'eau de mer, traitant plus de 100 millions de m³ par jour à l'échelle mondiale, la production d'eau ultrapure, le traitement des eaux usées (notamment pour la réutilisation des eaux usées traitées). Le marché global de l'osmose inverse est estimé à plus de 8 milliards de dollars par an, avec une croissance annuelle d'environ 7%.
Les membranes d'osmose inverse, généralement fabriquées à partir de polymères synthétiques comme le polyamide ou l'acétate de cellulose, font l'objet d'avancées constantes. L'utilisation de nanomatériaux pour améliorer la perméabilité et la sélectivité, ainsi que le développement de membranes anti-encrassement, représentent les innovations récentes les plus notables, permettant d'atteindre des taux de rejet de sel supérieurs à 99,8%.
L'intégration de l'osmose inverse dans les filières de traitement de l'eau implique un prétraitement, le procédé lui-même, et un post-traitement. Veolia, leader mondial dans ce domaine, a démontré l'efficacité de cette approche intégrée dans des projets majeurs dans le monde entier (Australie, Moyen Orient, Afrique du nord…). L'optimisation de ces filières est cruciale pour maximiser l'efficacité et minimiser les coûts opérationnels, qui peuvent varier de 0,5 à 1,5 $/m³ d'eau produite.
La consommation énergétique demeure un défi majeur, représentant environ 30 à 50% des coûts opérationnels. Veolia a relevé ce défi dans des projets comme l'usine de Sur à Oman, où des systèmes de récupération d'énergie innovants ont permis de réduire la consommation à moins de 3 kWh/m³. L'intégration d'énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne…) illustre les avancées en matière de développement durable.
Les perspectives futures de l'osmose inverse s'orientent vers le développement de membranes intrinsèquement plus performantes ou pilotées de manière plus "intelligentes", l'amélioration continue de l'efficacité énergétique, et une intégration plus poussée avec d'autres technologies de traitement. Les méga-usines de dessalement par osmose inverse, dont certaines atteignent des capacités de production de plus de 1 million de m³/jour, joueront un rôle crucial dans la sécurité hydrique mondiale, de même que celles de réutilisation des eaux usées. Veolia, avec son expertise dans la conception et l'exploitation de telles installations, est bien positionné pour relever les défis futurs de la durabilité environnementale et économique dans ce secteur en pleine expansion.
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
La France connaît une situation de crise dans l’approvisionnement en eau notamment depuis 2022. Les consommateurs et les industriels doivent donc miser sur la sobriété. Les entreprises industrielles dépendent de l’eau pour fonctionner et se développer : les problématiques liées à la qualité de l’eau représentent un risque croissant pour les exploitations. Le secteur agroalimentaire, dépendant de ressources en eau, se mobilise pour une évolution du cadre règlementaire s’agissant de la réutilisation des eaux non conventionnelles. L’approche est de réduire, réutiliser et recycler avec un objectif de 100% de réduction de la consommation
Le plan Eau permet la levée des barrières règlementaires avec la parution des décrets et arrêtés. Différents types d’eau sont rencontrées dans l’industrie agro-alimentaire. Le REUSE/REUT permet selon ces types d’eau une réutilisation des eaux issues des matières premières, des processus recyclées, des eaux usées traitées recyclées. La réutilisation d’autres types d’eau spécifique reste interdite.
Il existe aussi des freins économiques : le coût de l’eau est minimum pour un industriel mais l’eau recyclée est rarement compétitive. Des politiques publiques devraient être mises en place pour inciter les entreprises à investir dans des solutions innovantes de meilleure gestion de l’eau.
Références :
- Décret du 29 août 2023 - les usages et conditions d’utilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées.
- Décret du 24 janvier 2024 – cadre général de la production et de l’utilisation des eaux réutilisées pour la préparation de denrées alimentaires.
- Décret du 8 juillet 2024 autorisant l’utilisation de certaines eaux recyclées comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.
- Arrêté du 8 juillet 2024 mettant en oeuvre les décrets du 24 janvier 2024 et 8 juillet 2024.
Jérôme MONTAGNIER | Directeur Général de DR. KUEKE France
Source : Colloque Chimie et Eau, Fondation de la Maison de la Chimie, 6 novembre 2024
